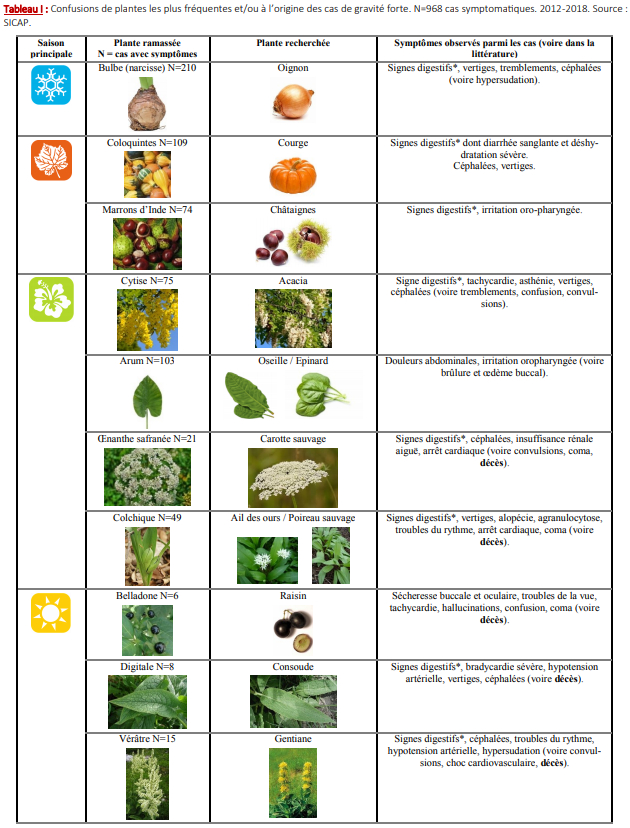« L’excès d’ondes émises par des mobiles mis sur le marché avant 2017 peut présenter des risques pour l’utilisateur
» lorsque gardés dans une poche, selon un avis de l’Agence française de sécurité de l’environnement (Anses) publié en octobre.
« Au moins 18 modèles sont concernés
», rapporte le magazine 60 Millions de consommateurs de l’Institut national français de la consommation.
« Un nombre important de téléphones conformes à la précédente réglementation encore utilisés présentent des niveaux d’exposition élevés lorsqu’ils sont placés près du corps », estime l’Agence qui s’est penchée sur le sujet suite à la publication par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de tests réalisés sur près de 300 téléphones entre 2012 et 2016.
60 Millions explique :
«
À l’époque, l’ANFR avait pris en compte les nouveaux usages des mobiles, portés plus près du corps. Elle avait notamment mesuré le débit d’absorption spécifique (DAS, l’indicateur d’exposition aux ondes) à 0,5 cm du corps, alors que la réglementation prévoyait uniquement des mesures à 2,5 cm maximum.Depuis, les mesures sont obligatoirement faites à 0,5 cm maximum, comme le prévoit la directive européenne RED. »
À partir des résultats de l’ANFR, 60 Millions a identifié 18 modèles qui ne sont pas conformes à la norme actuelle (à laquelle ils ne sont pas soumis). Leur DAS excède en effet la limite réglementaire de 2 watts par kilogramme (W/kg) à 0,5 cm du tronc.
- Blackberry : Q10 et Z10
- Honor: 7 Premium Or et X5
- Huawei: Ascend G300 et P9 (EVA-L09)
- HTC: One SV
- Lazer: Smartphone 3.0
- Motorola : Motoluxe et Razr i
- Nokia: Lumia 520
- Orange: Neva 80 (ZTE Blade V770)
- Polaroid: Pro 881A
- Samsung: Wave Y GT-S5380
- SFR : StarTrail 2
- Sony : Xperia E5 F3311 PM-0960-BV ; Xperia S Citizy LT26i ; Xperia T3
« Il est à noter que l’ANFR ne teste pas tous les mobiles, et que d’autres modèles sont donc potentiellement concernés
», souligne 60 Millions.
«
Dans leur rapport, les experts sollicités par l’Anses ont analysé la littérature scientifique sur le sujet afin d’évaluer les risques sanitaires et biologiques liés à une exposition supérieure à 2 W/kg.À défaut de l’existence d’études solides sur l’humain, ils se sont appuyés sur les récentes études – en faible nombre – réalisées in vivo chez des rongeurs ainsi que sur des cultures cellulaires.
Ils en concluent qu’un DAS supérieur à 2 W/kg peut notamment entraîner “des effets biologiques, en particulier sur l’activité cérébrale”. »
« L’Agence ajoute que les mesures de vérification de conformité du DAS des mobiles, pour être plus réalistes, devraient s’effectuer au contact du corps et non à 0,5 cm. Sur ce critère, plus de 200 téléphones testés par l’ANFR excèdent 2 W/kg…
»
« L’Anses recommande aux fabricants de procéder à la mise à jour des logiciels des appareils concernés, pour qu’ils réduisent leur DAS, ou d’organiser leur rappel auprès des consommateurs.
»
Téléphone : 6 comportements pour réduire l’exposition aux ondes (gouv. français)
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : 60 Millions de consommateurs, Anses.
Tous droits réservés