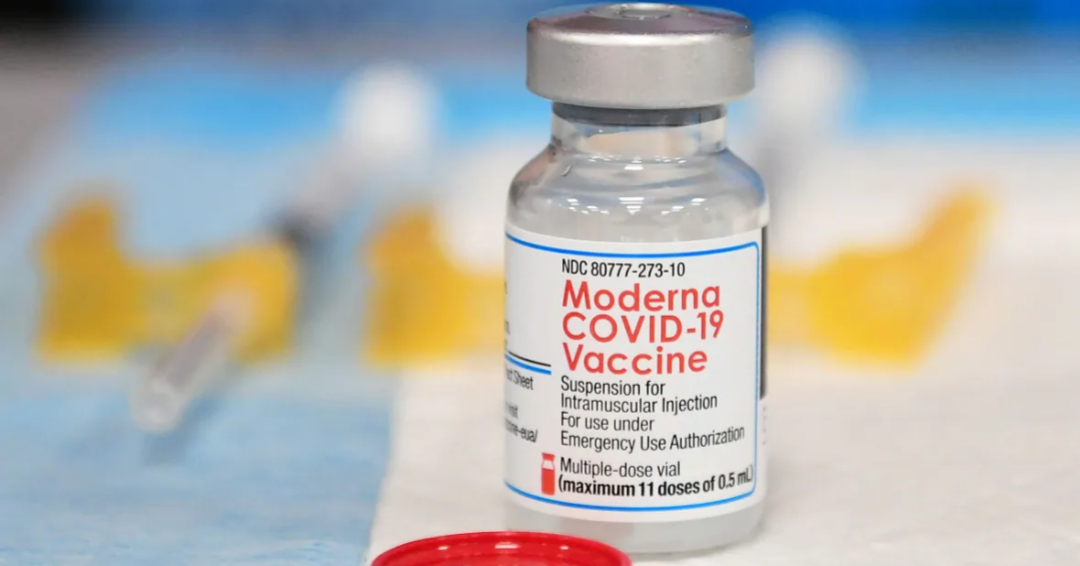Un homme de Gatineau, dans la province du Québec au Canada, a développé une grave condition de la peau après avoir reçu un vaccin contre le COVID-19, affirme qu’il est prêt à renoncer au système de santé canadien et à chercher un traitement à l’étranger. Continuer la lecture de La vaccination COVID provoque des souffrances intenses chez un Canadien
Archives par mot-clé : Canada
Cannabis : le groupe d’âge connaissant la plus forte progression (Canada)
Statistique Canada a publié, le 30 octobre, les chiffres de l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC) sur la consommation de cannabis.
Des statistiques sont publiées tous les 3 mois depuis la légalisation du cannabis récréatif en octobre 2018.
Pour les différents groupes d’âge, les proportions de répondants rapportant avoir consommé du cannabis dans les trois derniers mois étaient :
- 15 à 24 ans : 26 %
- 25 à 44 ans : 25 %
- 45 à 64 ans : 10 %
- 65 ans et plus : 7 %
C’est chez les 65 ans et plus que la plus forte progression est constatée. En 2012, ils étaient moins de 1 % à déclarer avoir consommé du cannabis.
Dans les trois derniers mois, plus d’un quart des personnes âgées consommant du cannabis étaient de nouveaux consommateurs.
Les 65 ans et plus sont moins susceptibles de consommer tous les jours ou presque tous les jours. Ils sont généralement plus susceptibles de consommer pour des raisons médicales.
«
Plus de la moitié (52 %) des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré consommer du cannabis exclusivement pour des raisons médicales, alors que la raison principale du reste des personnes âgées était répartie de façon égale entre une consommation à des fins non médicales uniquement (24 %) et une consommation à des fins à la fois médicales et non médicales (24 %).»
Globalement, près de 5,2 millions (ou 17 %) des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents. La consommation au Québec (11 %) est demeurée inférieure à la moyenne canadienne.
Un premier village Alzheimer au Canada ouvre ses portes
Le premier village Alzheimer au Canada a été inauguré en août, rapporte Radio-Canada.
Le Village Langley, en banlieue de Vancouver, accueille 75 patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de démence.
Il est inspiré de celui de Hogewey, situé près d’Amsterdam, aux Pays-Bas.
Construit sur 2 hectares hautement clôturés, « ce complexe conçu à la manière d’un village autonome favorise l’interaction sociale et la vie active. Il propose une épicerie, un salon de coiffure ainsi qu’un café autour d’une artère principale végétalisée.
»
Il inclut aussi un potager et une ferme. Il accepte les animaux de compagnie et compte pratiquement un employé par habitant.
Les villageois sont équipés de bracelets qui les géolocalisent à tout moment. Ils peuvent aller n’importe où dans le village, rencontrer d’autres villageois. C’est une petite communauté où tout le monde se connaît.
Radio-Canada décrit :
«
Chaque maisonnette loge une douzaine de patients dans des chambres individuelles.Rien n’est laissé au hasard : des tablettes disposées ici et là dans le salon rappellent le jour de la semaine, les jeux organisés contribuent à faire travailler la mémoire, alors que la décoration mise sur les références d’antan et l’aspect tactile.
Une cuisine commune favorise la participation aux tâches domestiques. À l’heure des repas, les patients qui le souhaitent sont invités à mettre la table.
À l’origine du projet du Village Langley, Elroy Jespersen s’est inspiré des modèles européens respectueux d’une forme d’intégrité sociale et humaine chez les personnes atteintes de démence.
J’ai voulu recréer plusieurs endroits qui donnent un objectif aux résidents, une destination où aller et une activité à y faire. Ça donne un sens à leur vie. »
Selon Habib Chaudhury du département de gérontologie de l’Université Simon Fraser (SFU), ce choix de logement adapté a déjà fait ses preuves.
« Ça réduit l’anxiété, l’agitation, la dépression, tout en favorisant l’interaction sociale. Les patients consomment moins de médicaments psychotropes. »
Ce modèle d’hébergement est toutefois réservé aux gens relativement fortunés : les coûts varient de 7300 $ et 8300 $ par mois, selon les soins fournis.
Pour plus d’informations sur la maladie d’Alzheimer, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : Radio-Canada, Radio-Canada.
Tous droits réservés
Syndrome de fatigue chronique (encéphalomyélite myalgique) : le Canada investit dans un réseau de recherche
L’investissement provient du gouvernement du Canada par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
« Les personnes atteintes ressentent notamment :
une fatigue intense et persistante à la suite d’une activité physique ou cognitive légère que le repos ne parvient pas à atténuer ;
de la douleur musculaire et articulaire ;
des maux de tête ;
l’incapacité de rester debout en raison d’une chute soudaine de la tension artérielle ;
une mauvaise qualité du sommeil. »
« Les causes ne sont pas bien comprises, et il n’existe aucun test diagnostique ni aucun remède.
»
Un article des IRSC, publié en juillet 2019, explique plus précisément :
«
L’EM/SFC est une maladie multisystémique chronique associée à une déficience neurologique, neurocognitive, immunologique, autonomique et du métabolisme énergétique aérobie. (Actualités de la recherche sur les causes du syndrome de fatigue chronique)Le symptôme caractéristique de cet état est un malaise après effort, une exacerbation retardée de symptômes et une perte d’endurance après un effort cognitif ou physique même anodin.
L’EM/SFC se manifeste souvent de façon soudaine, habituellement après une infection virale ou autre, mais peut également survenir à la suite d’autres types de traumatismes physiques. Les patients disent ressentir des symptômes “pseudogrippaux” de façon chronique. En plus de l’état de malaise consécutif à l’effort, les patients peuvent aussi ressentir une déficience cognitive, avoir un sommeil non réparateur et présenter des symptômes autonomiques comme une variabilité du rythme cardiaque et une intolérance orthostatique, une douleur musculaire et articulaire, et une sensibilité au bruit, à la lumière et aux produits chimiques.
L’EM/SFC peut être plus ou moins grave. Chez le même patient aussi, le degré de sévérité peut changer avec le temps, et d’un jour à l’autre, les symptômes augmentant ou diminuant. Les personnes atteintes d’EM/SFC ne peuvent vaquer à leurs activités courantes de manière prévisible ou constante. Jusqu’à 70 % des patients sont incapables de travailler et 25 % restent confinés au lit ou à leur domicile. »
Le réseau sera basé au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal. Il sera dirigé par Alain Moreau, professeur à l’Université de Montréal, avec la collaboration d’une équipe de patients partenaires, de cliniciens et de plus de 20 chercheurs.
Le Canada compte seulement trois cliniques spécialisées dans la prise en charge des patients atteints d’encéphalomyélite myalgique ou de maladies apparentées comme la fibromyalgie ou les hypersensibilités environnementales, à Vancouver, Toronto et Halifax, a indiqué le Dr Moreau à la Presse canadienne.
«
Cet investissement de 1,4 M$ sur cinq ans vise à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l’EM :
par l’étude des causes de l’EM, y compris des liens possibles avec des virus et des gènes ;
par l’établissement de liens entre des cohortes de patients et des chercheurs du Canada et des États-Unis, permettant aux chercheurs de partager leurs échantillons de recherche et leurs données cliniques, et d’échanger sur les méthodes d’analyse ;
par l’appui d’étudiants des cycles supérieurs travaillant sur l’EM pour développer les capacités de recherche du Canada sur cette affection ;
par l’utilisation des connaissances des personnes qui vivent avec l’EM et qui prennent une part active à la recherche. »
Le gouvernement américain a aussi récemment accéléré la recherche sur le syndrome : SFC : financement de trois centres de recherche aux États-Unis (2017).
Pour plus d’informations sur le syndrome de fatigue chronique, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : IRSC (communiqué), IRSC, La Presse canadienne.
Tous droits réservés
Parler de vapotage avec votre adolescent : une fiche de conseils de Santé Canada
Santé Canada a publié une fiche conseil pour aider les parents à discuter du vapotage avec leurs adolescents.
Selon un récent sondage de Santé Canada, 23 % des élèves de la 7e à la 12e année ont déjà utilisé la cigarette électronique.
Certaines caractéristiques peuvent rendre les produits de vapotage difficiles à reconnaître ou à détecter pour les parents : les dispositifs peuvent avoir différentes formes et tailles et peuvent même ressembler à une clé USB et le vapotage ne laisse pas forcément d’odeur identifiable persistante.
La fiche renseigne sur le vapotage et fournit des conseils pratiques pour amorcer et poursuivre la discussion avec les jeunes.
Renseignez-vous avant la discussion
Le vapotage peut exposer à des produits chimiques dangereux
«
Les ingrédients que l’on trouve habituellement dans les liquides de vapotage incluent notamment le glycérol, les arômes, le propylèneglycol et diverses concentrations de nicotine. Les effets à long terme de l’inhalation de ces substances dans les produits de vapotage sont inconnus et continuent d’être évalués.Le vapotage ne nécessite pas de combustion, plutôt, le liquide est chauffé. Ce processus peut provoquer des réactions et créer de nouveaux produits chimiques (comme du formaldéhyde). Certains contaminants (comme des métaux) pourraient aussi se retrouver dans les produits de vapotage, puis dans la vapeur. »
Le vapotage peut entraîner une dépendance à la nicotine
« Pour les fumeurs, le vapotage est moins nocif que le tabagisme.
» Toutefois, les produits de vapotage qui contiennent de la nicotine comportent des risques pour les jeunes.
«
La nicotine engendre une très forte dépendance. Les jeunes sont particulièrement sensibles à ses effets néfastes, car il est établi que la nicotine altère le développement cérébral et peut nuire à la mémoire et à la concentration. Elle peut également mener à la dépendance, notamment la dépendance physique.Les produits de vapotage ne contiennent pas tous de la nicotine, mais pour ceux qui en contiennent, la teneur en nicotine peut varier considérablement. Certains mélanges ont une très faible teneur en nicotine, tandis que d’autres peuvent en contenir plus qu’une cigarette normale. Même si un produit de vapotage ne contient pas de nicotine, vous risquez d’être exposé à d’autres substances chimiques nocives. »
Conseils pour la discussion
« Profitez des situations où vous pouvez parler de vapotage
», est-il conseillé. (…) Par exemple, lorsque vous passez devant un groupe d’adolescents qui vapotent, profitez-en pour aborder le sujet avec votre ado. Présentez les faits et corrigez toute idée fausse. »
« Soyez patient et à l’écoute : évitez la critique et encouragez un dialogue ouvert ; n’oubliez pas que votre objectif est d’avoir une discussion constructive et non de donner une leçon.
»
« Ne vous attendez pas à n’avoir qu’une seule discussion avec votre enfant. Vous devrez probablement parler du sujet plusieurs fois.
»
Fiche-conseil de Santé Canada : Parler de vapotage avec votre adolescent : une fiche de conseils pour les parents
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
Psychomédia
Tous droits réservés
Les produits homéopathiques ne peuvent remplacer les vaccins, met en garde Santé Canada
Santé Canada a eu connaissance de reportages (en anglais) selon lesquels certains homéopathes et naturopathes font la promotion de produits homéopathiques, appelés nosodes, pour l’« homéoprophylaxie » et laissent entendre que ces produits peuvent protéger les enfants contre des maladies infectieuses, rapporte un communiqué de l’agence publié le 6 mars.
L’agence précise :
«
Les nosodes ne sont pas approuvées par Santé Canada comme remplacement des vaccins et ne l’ont jamais été. Rien ne prouve leur efficacité dans la prévention ou le traitement des maladies infectieuses. Aucun produit homéopathique ne devrait être promu comme solution de rechange aux vaccins, car il n’existe aucun substitut aux vaccins.»
Santé Canada exige que l’étiquette de tous les produits homéopathiques à base de nosodes comporte les mentions suivantes pour indiquer clairement qu’il ne s’agit ni de vaccins ni de substituts vaccinaux :
-
« Ce produit n’est ni un vaccin, ni une solution de rechange à la vaccination. »
-
« L’efficacité de ce produit n’a pas été prouvée pour la prévention d’une infection. »
-
« Santé Canada ne recommande pas son utilisation chez les enfants et conseille que votre enfant reçoive tous les vaccins courants. »
«
Les enfants à qui l’on a donné des nosodes au lieu de vaccins risquent de développer des maladies infantiles graves et potentiellement mortelles comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, la poliomyélite et la coqueluche.»
« Si vous êtes le parent ou le tuteur d’un enfant qui n’est pas vacciné, agissez maintenant et parlez à un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes à ce sujet
», recommande l’agence.
Santé Canada fournit sur cette page des liens vers des sources d’information crédibles sur la vaccination : Les remèdes homéopathiques ne remplacent pas les vaccins
Aucun « médicament » homéopathique n’est un vaccin contre la grippe, met en garde l’ANSM
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
Psychomédia
Tous droits réservés.
Toux et rhume : les médicaments contenant codéine, hydrocodone et norméthadone déconseillés chez les enfants et ados (Santé Canada)

Santé Canada déconseille, par précaution, l’utilisation des médicaments contre la toux et le rhume qui contiennent des opioïdes tels que la codéine, l’hydrocodone et la norméthadone, chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans).
« Il y a très peu de données confirmant l’efficacité de ces produits chez les moins de 18 ans.
»
« Bien que l’examen n’ait pas permis de trouver de preuves solides établissant un lien entre l’utilisation de produits contre la toux et le rhume qui contiennent des opioïdes et le risque de troubles liés à l’usage d’opioïdes chez les enfants et les adolescents, il en est quand même ressorti que la consommation de ces substances tôt dans la vie pouvait constituer un facteur de consommation problématique plus tard
», indique le communiqué.
« Trois opioïdes d’ordonnance sont autorisés pour traiter les symptômes de la toux au Canada : la codéine, l’hydrocodone et la norméthadone. La codéine est également offerte sans ordonnance dans des formulations à faible dose pour traiter la toux et le rhume.
»
« Au Canada, l’utilisation de médicaments d’ordonnance contre la toux et le rhume contenant des opioïdes a diminué chez les enfants et les adolescents au cours des cinq dernières années. Actuellement, l’utilisation de ces produits par les moins de 18 ans représente une faible proportion (4 %) de l’ensemble des ordonnances de médicaments opioïdes contre la toux et le rhume délivrés au Canada.
La plupart des médicaments contre la toux sont inefficaces et à éviter, selon “60 millions de consommateurs”
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec source : Santé Canada.
Tous droits réservés
Insomnie : la proportion d’adultes touchés est en hausse au Canada
Entre 2007 et 2015, la proportion d’adultes touchés par l’insomnie au Canada est passée de 17 à 24 %, soit une hausse de 42 %, selon des chiffres de Statistique Canada analysés par le professeur Charles Morin de l’École de psychologie de l’Université Laval (Québec) et ses collègues.
Les données étudiées sont celles d’enquêtes menées entre 2007 et 2015 auprès de 21 826 Canadiens de 6 à 79 ans.
Les résultats sont publiés dans la revue Health Reports.
Les femmes sont davantage touchées par l’insomnie. En 2015, chez les 18 à 64 ans, 30 % des femmes rapportaient en souffrir, ce qui était le cas de 21 % des hommes.
En 2015, l’insomnie touchait 15 % des 14 à 17 ans et 9 % des 6 à 13 ans.
Dans tous les groupes d’âge, l’insomnie est en hausse.
Ce qui peut s’expliquer par deux facteurs, avance Charles Morin. « D’une part, les gens sont davantage sensibilisés au problème et ils en connaissent mieux les manifestations, ce qui fait qu’ils le rapportent davantage dans les enquêtes. D’autre part, des changements dans le mode de vie, notamment l’omniprésence des écrans rétroéclairés et leur abondante utilisation, peuvent nuire au sommeil.
» (TEST : Quelle est la sévérité de votre insomnie ?)
L’insomnie, souligne le chercheur, est notamment un facteur de risque pour la dépression et l’hypertension.
« En Europe et aux États-Unis, mentionne-t-il, le traitement de l’insomnie fait maintenant partie des guides de pratiques cliniques publiés par les autorités médicales. Au Canada, une réflexion est amorcée en ce sens et les compagnies d’assurance sont particulièrement préoccupées par ce problème.
»
L’étude est signée par Jean-Philippe Chaput, du Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute, par Jessica Yau et Deepa P. Rao, de l’Agence de la santé publique du Canada, et par Charles Morin.
Pour plus d’informations sur l’insomnie, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : Université Laval (Le Fil), Statistique Canada.
Tous droits réservés.
La poudre de talc pourrait causer des lésions pulmonaires et le cancer des ovaires (Santé Canada)
L’inhalation de poudre de talc libre peut causer des effets pulmonaires tels qu’une diminution de la fonction pulmonaire et la fibrose alors que l’exposition de la région génitale à certains produits contenant du talc est une cause possible du cancer de l’ovaire, selon une « ébauche d’évaluation » soumise à la consultation publiée par
le 5 décembre.
« Le talc est un minéral naturellement présent dans l’environnement qui est utilisé comme ingrédient dans une grande variété de produits, dont les cosmétiques, les produits de santé naturels et les médicaments en vente libre.
»
Les produits visés sont les cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments en vente libre contenant du talc se présentant sous forme de poudres libres (poudre pour le visage, poudre pour le corps, poudre pour bébé et poudre pour les pieds) et produits utilisés dans la région périnéale (poudre pour le corps, poudre pour bébé, crèmes pour les irritations et l’érythème fessier, antisudorifiques et déodorants génitaux, lingettes pour le corps et bombes effervescentes pour le bain).
« Comme les particules de talc sont persistantes, elles s’accumulent dans les tissus pulmonaires humains. Cette accumulation peut entraîner à la fois une altération de la fonction d’autopurification (diminution de la capacité à combattre les infections), des changements inflammatoires et une fibrose.
»
« L’ébauche d’évaluation montre également que le talc est une cause possible du cancer de l’ovaire lorsque la région génitale de la femme y est exposée. La Société canadienne du cancer indique que l’utilisation du talc sur les parties génitales est un facteur de risque possible du cancer de l’ovaire. Plusieurs méta-analyses publiées ont rapporté de façon constante une association positive modeste entre le cancer de l’ovaire et l’exposition périnéale au talc.
»
L’évaluation « n’a mis en évidence aucun effet critique sur la santé pour une exposition par voie orale, par exemple pour du talc dans des médicaments, ou par des voies d’exposition cutanées (autres que périnéales)
» (ex. poudres compressées des fards à paupières ou à joues).
Santé Canada « demande aux professionnels de la santé de rappeler à leurs patients :
- d’éviter d’inhaler les poudres libres de talc ;
- d’éviter d’exposer les organes génitaux féminins aux produits contenant du talc ;
- de tenir la poudre pour bébé loin du visage des enfants afin d’éviter l’inhalation ;
- de vérifier les étiquettes des produits pour savoir s’ils contiennent du talc et choisir des solutions de rechange sans talc si l’utilisation de celui-ci les préoccupe. »
Poudre pour bébé J & J et cancer : amende de 4,69 milliards aux États-Unis et recours collectif au Québec (2018)
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : Santé Canada, Santé Canada, La Presse canadienne (Radio-Canada).
Tous droits réservés.
Halloween : précautions à prendre avec les lentilles cornéennes à but esthétique (Santé Canada)
Les lentilles cornéennes à but esthétique présentent des risques pour la santé, rappelle Santé Canada à l’approche de l’Halloween.
- des réactions allergiques (p. ex. picotement, larmoiement ou rougeur des yeux) ;
- des troubles visuels ;
- des infections ;
- la cécité.
Le risque d’effets secondaires « est plus élevé chez les fumeurs et les personnes ayant certains problèmes de santé, comme une infection des yeux ou une sécheresse oculaire. Le risque est aussi plus grand s’il s’agit de lentilles à but esthétique qui ne sont pas homologuées ni délivrées sur ordonnance.
»
«
Santé Canada a commencé à réglementer ces produits à titre d’instruments médicaux en 2016. Les lentilles cornéennes à but esthétique doivent donc être homologuées par Santé Canada avant de pouvoir être vendues. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale.Les lentilles à but esthétique homologuées par Santé Canada ont fait l’objet d’une évaluation visant à en assurer l’innocuité, l’efficacité et la qualité. Utiliser des lentilles non homologuées pourrait mettre votre santé en péril. En date d’octobre 2018, les entreprises qui fabriquent des lentilles à but esthétique homologuées par Santé Canada sont les suivantes :
Alcon Laboratories Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Ciba Vision Corporation
Coopervision Inc.
Geo Medical Co., Ltd.
Les entreprises Lesieur inc.
Neo Vision Co. Ltd.
Unicon Optical Co., Ltd. »
Les précautions suivantes sont nécessaires :
-
«
Nettoyez et désinfectez adéquatement les lentilles en suivant les directives accompagnant le produit.
-
Lavez et essuyez bien vos mains avant de manipuler et de nettoyer des lentilles à but esthétique.
-
N’échangez et ne partagez jamais de lentilles à but esthétique avec quelqu’un d’autre.
-
Ne vous couchez jamais avec des lentilles à but esthétique à moins qu’elles soient conçues pour un port prolongé.
-
Consultez un professionnel de la vue si vous avez utilisé des lentilles à but esthétique et que vous êtes inquiet de votre santé. En cas de rougeur des yeux, de vision trouble, d’écoulement continu ou de sensibilité à la lumière, retirez les lentilles immédiatement et consultez un professionnel de la vue. Si le problème n’est pas traité, il pourrait entraîner la cécité. »
« Consultez un professionnel de la vue si vous songez à porter des lentilles à but esthétique pour l’Halloween ou pour toute autre raison. Il pourra vous conseiller sur le matériau, les éléments de conception et le mode d’entretien des lentilles qui conviennent le mieux à vos yeux
», conseille aussi Santé Canada.
Pour plus d’informations relatives à l’Halloween, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec source : Santé Canada.
Tous droits réservés.