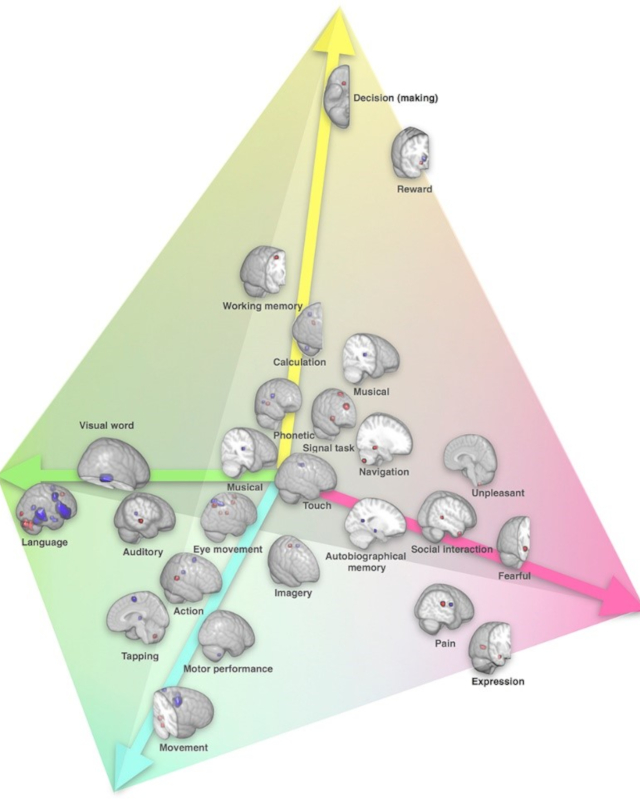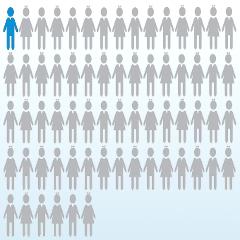Le cauchemar, « un rêve extrêmement dysphorique », implique généralement des menaces vitales sur la sécurité ou l’intégrité physique. Il est aussi caractérisé par un état rapidement orienté et alerte après l’éveil (contrairement à d’autres troubles du sommeil tels que les terreurs nocturnes.
Une survenue répétée et un retentissement sur la vie de la personne constituent le « trouble cauchemars ».
Psychothérapies
Plusieurs traitements psychologiques sont utilisés dans la prise en charge de ce trouble.
Alain Perrier et Pierre Geoffroy de l’Université de Paris ont, avec leurs collègues, recensé ces traitements dans un article publié en juillet 2021 dans la revue Médecine du Sommeil.
«
Les approches non pharmacologiques dérivées des thérapies cognitivo-comportementales sont celles qui ont fait la preuve de l’efficacité la plus robuste», rapportent-ils.«
La thérapie par répétition d’imagerie mentale (RIM) est le seul traitement faisant actuellement l’objet de recommandations de grade A par les sociétés savantes.Cette thérapie comprend un volet d’éducation thérapeutique et de restructuration cognitive, ainsi qu’un volet centré sur la pratique de l’imagerie mentale consistant à modifier un cauchemar préexistant pour créer le scénario d’un nouveau rêve qui sera répété quotidiennement durant l’éveil.
D’autres traitements psychothérapeutiques peuvent être utilisés, notamment les thérapies d’exposition et de désensibilisation, les thérapies centrées sur les rêves lucides, et dans une moindre mesure les thérapies cognitivo-comportementales classiques ou spécifiques de l’insomnie. »
Traitement pharmacologique
« L’utilisation des traitements pharmacologiques, au premier rang desquels se trouve la prazosine, se limite à certaines indications précises comme les cauchemars liés au trouble de stress posttraumatique.
»
Pour plus d’informations sur les cauchemars et autres troubles du sommeil, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec source : Médecine du sommeil.
Tous droits réservés.