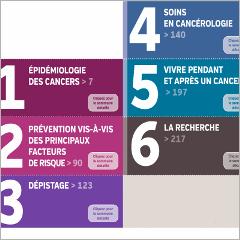Alors que l’épidémie de Covid-19 a déjà fait plus de deux millions de morts dans le monde, l’apparition de nouveaux variants suscite toutes les interrogations. Variant britannique, variant sud-africain, variant brésilien… On fait le point sur la situation des nouveaux variants du coronavirus dans le monde.
Plus de 2 millions de morts de la Covid-19 dans le monde
Ce mercredi 20 janvier 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé fait état de plus de deux millions de morts de la Covid-19 dans le monde. Les Etats-Unis étant le pays le plus touché avec au moins 401 361 décès, suivis du Brésil avec 211 491 morts, de l’Inde avec 152 556 décès, du Mexique avec 141 248 et du Royaume-Uni avec 91.470 personnes décédées de la Covid-19 selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.
Par ailleurs, l’Agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour la santé publique note une augmentation de 9% du nombre de décès au cours de la semaine se terminant le 17 janvier par rapport à la semaine précédente, pour atteindre le nombre record de 93.000 décès.
Le variant anglais identifié dans 60 pays et territoires contre 23 pour le variant sud-africain
Alors que le variant britannique signalé en mi-décembre dernier est considéré 50 à 70 % plus contagieux, sa présence a été identifié dans les 6 zones géographiques de l’OMS contre 4 zones pour le variant sud-africain. S’ils ne sont, à priori, pas plus dangereux que le nouveau coronavirus originel, ces variants étant plus contagieux, augmentent la pression sur les systèmes de santé.
Selon les données de l’OMS, le variant britannique a été identifié, la semaine précédente, dans 60 pays et territoires. C’est 10 zones géographiques de plus qu’au 12 janvier dernier. Quant au variant sud-africain qui se diffuse plus lentement, l’OMS a tout de même déclaré l’avoir identifié dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus que la semaine précédente.
Apparition de deux autres variants au Brésil
L’OMS a également mentionné l’apparition de deux autres variants apparus au Brésil dont le P1 qui a été identifié à l’aéroport de Haneda au Japon, lors d’un dépistage sur des personnes en provenance de Manaus au Brésil, le 15 décembre dernier. Selon l’agence onusienne, « Il y a actuellement peu d’informations disponibles pour évaluer si la transmissibilité ou la sévérité sont modifiés par ces nouveaux variants ». Ces variants ayant des caractéristiques génétiques similaires aux variants britannique et sud-africain réclament des études plus poussées pour comprendre leur impact.
Pour l’heure, l’efficacité des vaccins anti-Covid-19 contre ces variants n’est pas encore établie même si des laboratoires ont assuré être capables de fournir rapidement de nouvelles versions de leur vaccin si besoin.