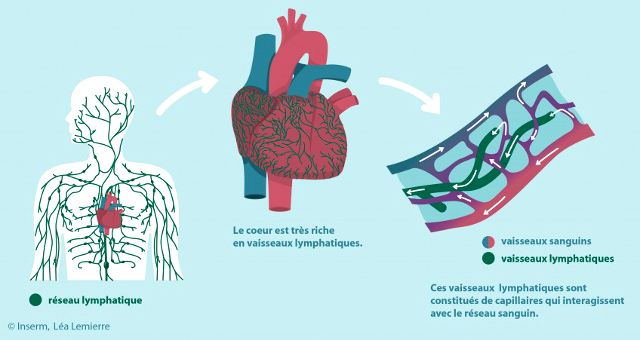Le 26 mai 2016.
Tous les patients atteints d’une hépatite C auront désormais accès au traitement miracle, mais très cher, qui était jusqu’ici réservé à certains cas avancés. La ministre de la Santé répond ainsi à une vive exigence des personnels soignants et des associations.
L’accès aux traitements contre l’hépatite C devient universel
« Aujourd’hui, je décide l’accès universel aux traitements de l’hépatite C », a ainsi annoncé Marisol Touraine. « Le progrès thérapeutique permet aujourd’hui de guérir l’hépatite C. Les nouveaux traitements disponibles sur le marché sont, à ce titre, porteurs d’espoir pour les 500 000 personnes atteintes de cette maladie en France », a encore détaillé la ministre. « Nous devons aujourd’hui aller plus loin et garantir l’accès de tous les malades à ces traitements ».
Près de 60% des malades ignorent qu’ils le sont
Le traitement en question, baptisé Harvoni, a été lancé par le laboratoire américain Gilead. Il coûte 46 000 € et permet une guérison complète du patient en 12 semaines. « Plus de 30 000 malades » très atteints ont été soignés, selon les chiffres annoncés par la ministre.
En France, on estime à environ 4 000 le nombre de nouveaux cas d’infection par an, selon les données de l’Institut Pasteur. Ce n’est cependant pas ce chiffre qui inquiète le plus les autorités. En effet, près de 60 % de ces personnes ignoreraient qu’elles sont porteuses de cette maladie du foie, qui trouve son origine dans un virus et qui peut se transformer en cirrhose ou en cancer du foie si elle n’est pas diagnostiquée.