
Le 11 février 2019.
Scandale sanitaire en vue ? À priori non. Néanmoins, les femmes, sous traitement hormonal, devraient prendre rendez-vous avec leur médecin : des médicaments à base de progestérone provoqueraient des tumeurs au cerveau.
70 cas de méningiomes
Les médicaments à base d’hormones seraient-ils dans la tempête ? Après Androcur, un traitement contre la pilosité, accusé en septembre 2018 de favoriser la survenue de méningiomes, c’est au tour des traitements contre les symptômes de la ménopause -entre autres- qui sont dans le collimateur de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).
Il s’agirait des mêmes conséquences que pour Androcur, autrement dit, de méningiomes. Aujourd’hui, on rapporte 70 cas environ. Une cinquantaine concerne le Lutényl (acétate de nomégestrol) et une vingtaine de Lutéran (acétate de chlormadinone). Ces deux progestatifs sont généralement prescrits aux femmes souffrant de troubles liés à la ménopause, d’endométriose et autres problèmes gynécologiques.
Une tumeur au cerveau bénigne
Dans un communiqué datant du 7 février 2019, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a fait savoir que « des cas de méningiomes, associés à l’utilisation d’acétate de chlormadinone ou d’acétate de nomégestrol ont été observés lors de l’utilisation de ces médicaments à des doses thérapeutiques ».
Inutile de paniquer néanmoins, le méningiome est une tumeur bénigne, dans la majorité des cas. Il se développe au niveau des méninges, plus précisément à partir des membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Par ailleurs, l’ANSM se montre rassurante puisque « ces signalements ne permettent pas de conclure, à ce stade, que les femmes qui utilisent ces médicaments, présentent un risque de méningiome plus élevé que celui observé dans la population générale ».
Néanmoins l’ANSM indique un certain nombre de recommandations aux médecins, comme une prescription aux doses les plus faibles, sur une durée la plus courte possible, avec une évaluation de la balance risque/bénéfice.
Perrine Deurot-Bien
Lire aussi : Des conseils pour bien vivre sa ménopause


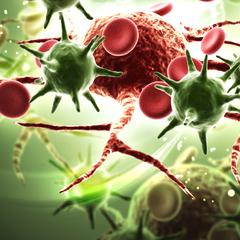
 La plupart de ces tumeurs sont à croissance lente et peuvent se « chroniciser », d’autres sont plus agressives et évoluent rapidement. Elles présentent une faible chimio et radio-sensibilité, d’où la place des récentes thérapies ciblées.
La plupart de ces tumeurs sont à croissance lente et peuvent se « chroniciser », d’autres sont plus agressives et évoluent rapidement. Elles présentent une faible chimio et radio-sensibilité, d’où la place des récentes thérapies ciblées. En cas d'obésité, le risque de développer un second cancer est majoré de 37 à 40 %.
En cas d'obésité, le risque de développer un second cancer est majoré de 37 à 40 %.