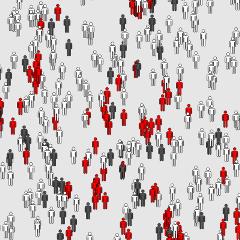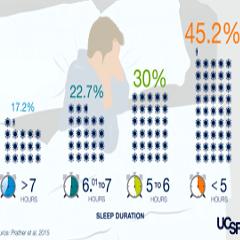Des résultats élevés aux questionnaires (tests) d’authenticité sont liés à un plus grand bien-être. Mais l’évaluation de l’authenticité au moyen de ces questionnaires peut être limitée dans la mesure où elle ne reflète pas complètement l’expérience vécue.
Les psychologues américains Joshua A.Wilt, Sarah Thomas et Dan P. McAdams (1) ont utilisé l’approche de l’identité narrative « afin de mieux saisir la richesse et les nuances de l’expérience authentique individuelle
».
Leurs résultats sont publiés dans la revue Heliyon éditée par le groupe Cell Press.
Ils ont mené deux études complémentaires. Dans la première, 87 étudiants de premier cycle universitaire ont décrit par écrit trois souvenirs distincts : un dans lequel ils s’étaient sentis authentiques, un dans lequel ils s’étaient sentis inauthentiques, et un souvenir émotionnel.
L’analyse thématique a identifié cinq dimensions de l’authenticité et 4 dimensions de l’inauthenticité.
Dimensions de l’authenticité
- l’authenticité relationnelle ;
- la résistance aux pressions extérieures ;
- l’expression du vrai soi ;
- la satisfaction (notamment sentiment de confort) ;
- l’appropriation de ses actions (agir selon ses valeurs et ses choix, accepter la responsabilité).
Dimensions de l’inauthenticité
- la simulation, l’hypocrisie ;
- la suppression des émotions ;
- l’abnégation ;
- la conformité.
Dans la deuxième étude, 103 étudiants de premier cycle ont fourni des descriptions écrites d’expériences authentiques et inauthentiques. Les scènes ont été codées en fonction des dimensions d’authenticité et d’inauthenticité identifiées dans la première étude, et ces résultats ont été mis en relation avec les résultats de questionnaires (tests) mesurant l’authenticité (dont l’Échelle d’authenticité de Wood) et des concepts reliés : l’autonomie (qui est un besoin fondamental selon la théorie de l’autodétermination), l’honnêteté (mesurée par une sous-échelle du test HEXACO) et le machiavélisme.
Il y avait plusieurs corrélations statistiquement significatives entre les thèmes narratifs des participants et les variables mesurées par les tests. Les auteurs discutent de l’intérêt pour la recherche de ces corrélations.
Pour plus d’informations, voyez les liens plus bas.
(1) Universités Case Western Reserve et Northwestern.
Psychomédia avec source : Heliyon.
Tous droits réservés